Comment les jeunes d’aujourd’hui comprennent-ils le droit international humanitaire (DIH) et les règles applicables dans les conflits armés et qu’en pensent-ils ? Il n’est pas surprenant que les jeunes d’aujourd’hui soient de plus en plus affectés par la guerre, dans un monde qui gagne en complexité. Nous constatons une participation active des jeunes qui est sans précédent : ils organisent des manifestations ou y participent, rapportent et diffusent des témoignages sur les réseaux sociaux, font du bénévolat pour diverses organisations, engagent un dialogue difficile avec les décideurs et, bien sûr, vivent dans des pays en proie à des conflits armés.
Dans cet épisode de Humanity in War, Elizabeth Rushing, animatrice du podcast, s’entretient avec trois jeunes humanitaires au parcours remarquable (Julie Lefolle, Silvia Gelvez et Kay von Mérey) qui échangent leurs points de vue sur le DIH et l’action humanitaire, leur perception du travail qu’il reste à accomplir et leur espoir de poursuivre les efforts alors qu’une nouvelle année commence.
Aujourd’hui, j’aimerais ouvrir la discussion avec Julie Lefolle, associée juridique (Legal Associate) au sein du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ici à Genève. Julie, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle en tant qu’associée juridique au CICR ? Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez et qu’est-ce qui vous a poussée à travailler dans ce domaine ?
Julie : Oui, bien sûr. Je suis française, mais ma famille est originaire d’Haïti, un pays magnifique où je me rends tous les deux ans depuis que je suis toute petite. J’ai pu aller à l’école là-bas et j’ai constaté que la vie était très différente de celle que nous connaissons ici. La population a été confrontée à d’importantes difficultés, telles que la dictature, les interventions internationales, les catastrophes naturelles et la violence des gangs.
En grandissant, j’ai vu des personnes de mon entourage bénéficier de l’aide humanitaire. J’ai vu des Casques bleus, des Land Cruisers de la Croix-Rouge partout, j’ai vu les camps des Nations Unies se construire. J’ai vu les activités humanitaires et constaté qu’elles pouvaient être utiles, mais aussi que le secteur humanitaire pouvait créer des problèmes. Je pense en particulier à la corruption, aux scandales liés à des violences sexuelles, à l’usage excessif de la force, etc. J’ai toujours eu envie d’agir et je veux comprendre comment les décisions sont prises et comment nous pouvons nous battre pour que l’aide humanitaire soit apportée aux populations de manière respectueuse.
J’ai décidé d’étudier le droit et, pendant trois ans, j’ai travaillé sur la migration ; j’aidais les populations à obtenir des titres de séjour et à accéder à des soins de santé. J’ai également travaillé avec la Croix-Rouge française pour aider des membres de familles à se retrouver après avoir perdu contact en raison d’un conflit armé ou de la migration.
Maintenant, je suis associée juridique (Legal Associate) au sein de la Division juridique du CICR. J’ai eu la chance de pouvoir travailler dans trois unités différentes. J’ai d’abord travaillé pour l’unité privilèges et immunités, où j’ai aidé à protéger la confidentialité du CICR. Ensuite, j’ai rejoint l’unité des Commentaires, qui porte sur l’interprétation du droit de la guerre (les Conventions de Genève) à la lumière des conflits contemporains. La troisième unité, pour laquelle je travaille depuis le début de l’année, est celle qui fournit des conseils juridiques pour les opérations : nous fournissons des conseils juridiques qui peuvent concrètement aider les personnes dans les pays où des opérations militaires sont menées, dans le cadre du dialogue instauré avec les États, les militaires ou avec des groupes armés. Nous travaillons également sur la qualification des situations de violence, c’est-à-dire que lorsque les hostilités ou les combats commencent, nous établissons s’il s’agit simplement d’une situation de violence ou si, conformément au droit international humanitaire, il s’agit d’un conflit armé international ou non international, qui déclenche l’application du DIH.
Pour aller plus loin, comment pensez-vous que les jeunes comme vous qui travaillent sur ces thématiques peuvent contribuer au DIH et aux politiques humanitaires ?
Julie : Je pense qu’il est important de tenir compte du fait que notre génération a grandi avec un accès quasi illimité aux informations. Lorsqu’un professeur ou une famille affirmait quelque chose, j’avais toujours accès à des informations me permettant de vérifier leurs propos. J’avais aussi accès à des informations venues de l’autre bout du monde. Nous sommes donc issus d’une génération qui s’affirme et qui a confiance en ce qu’elle pense, parce que nous avons accès à des informations qui confirment que notre raisonnement est le bon.
Je pense que ce qui est important pour nous, c’est de nous lancer dans ce domaine avec la certitude que nous n’allons pas faire de compromis sur nos valeurs et que nous allons toujours exiger davantage. Nous remercions la génération précédente pour tout ce qu’elle a acquis pour nous. Mais nous pouvons également dire que nous voulons plus d’égalité entre les genres. Nous voulons plus de droits pour les personnes avec un handicap. Nous voulons que les conséquences de l’intersectionnalité soient prises en compte. Nous voulons que le racisme n’ait plus sa place dans le droit et l’action humanitaire. Et nous ne nous en excuserons pas.
D’autre part, nous savons à quel point il est important et urgent de faire évoluer le droit et les politiques humanitaires lorsque nécessaire, car nous avons grandi en voyant les conséquences des conflits armés et en sachant les nommer. Si je prends l’exemple du Rwanda, il s’agit d’un génocide. En ce qui concerne l’Afrique du Sud, il s’agissait d’apartheid. Quant à l’Irak, on parle d’occupation. Nous avons grandi avec ces mots, en les utilisant, en évoquant le droit international dans notre vie quotidienne.
C’est l’occasion de vous présenter notre prochaine invitée, Kay Von Merey, qui dirige le Cercle des jeunes humanitaires, une organisation qu’elle a fondée.
Pour commencer, nous aimerions en savoir plus sur la raison d’être du Cercle des jeunes humanitaires. Pourriez-vous commencer par décrire l’organisation que vous avez fondée, expliquer ce qui vous a poussée à la créer, puis décrire quelques-uns des principaux objectifs d’une organisation orientée vers la jeunesse telle que le Cercle ?
Kay : Le Cercle des jeunes humanitaires est une association à but non lucratif neutre sur le plan politique, basée à Zurich et fondée en coordination avec le CICR au printemps 2021. Pour faire simple, nous reconnaissons qu’à l’ère du numérique, les jeunes sont constamment exposés à des images et des vidéos montrant des conflits et des guerres sur les réseaux sociaux, ce qui leur donne souvent un sentiment d’impuissance. De plus, la quantité d’informations disponibles peut également conduire à de la désinformation et à une polarisation. Cette situation risque de susciter une certaine méfiance à l’égard des organisations humanitaires et même plus globalement à l’égard des structures sociales.
Le Cercle vise précisément à combler ce fossé entre le monde humanitaire et la génération à venir, car nous savons que le regard que les jeunes portent aujourd’hui sur la guerre et sur les autres situations d’urgence humanitaire influencera la direction que prendra le monde à l’avenir. Pour faciliter cette démarche, le Cercle propose une plateforme visant à promouvoir un dialogue ouvert et efficace afin d’encourager les débats sur les défis humanitaires dans le monde.
Un bon exemple pour illustrer nos efforts est celui du premier sommet des jeunes humanitaires organisé en mars à Zurich avec le soutien du CICR. Ce forum de deux jours a réuni plus de 300 jeunes et a permis de favoriser un échange intergénérationnel et interdisciplinaire sur des questions humanitaires.
Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, à savoir comment j’en suis venue à fonder le Cercle des jeunes humanitaires, tout a commencé quand j’étais à l’école primaire. Je me souviens avoir été captivée par ce que me disait une amie du travail de son père, délégué au CICR. Cette exposition précoce a suscité un vif intérêt pour le secteur humanitaire, ce qui m’a amenée à faire du bénévolat pour la Croix-Rouge autrichienne et dans un hôpital en Équateur pendant mon année de césure après le lycée. Cela m’a conduite à faire un stage au CICR en 2020, au cours duquel j’ai remarqué que les jeunes en Suisse étaient peu sensibilisés à l’importance du travail des organisations humanitaires telles que le CICR.
Consciente de la nécessité d’une plateforme qui pourrait amener les jeunes à se rapprocher du secteur humanitaire, j’ai fait part de mon idée à mes superviseurs de l’époque au CICR, qui m’ont tout de suite soutenue. J’ai contacté des amis, je leur ai demandé si cela pourrait les intéresser, et cela m’a amené à discuter avec Jessica Eberhart et Leonie Basler, deux amies qui ont fini par devenir cofondatrices.
Nous avons toutes les trois développé ce concept et travaillé ensemble pour donner vie à ce projet innovant. Ainsi, ce qui a commencé avec trois jeunes femmes inspirées du CICR il y a deux ans et demi s’est transformé en une organisation de 40 jeunes professionnels et étudiants qui se sont portés volontaires pour soutenir la cause du Cercle. Pour résumer, cette cause ne se limite pas à l’organisation de plusieurs événements. Le Cercle a été conçu pour servir de boussole permettant de nous éloigner des conflits et de nous diriger vers la paix. Nous nous efforçons de créer des liens et de rappeler à tous que la consolidation de la paix nécessite des efforts et un engagement.
J’aimerais que vous nous aidiez à comprendre pourquoi il est si important pour les jeunes de bénéficier d’une plateforme comme la vôtre. Et surtout, pourquoi est-ce important qu’ils y contribuent ?
Kay : Les réseaux sociaux représentent une question déjà très importante sur laquelle j’aimerais me pencher. Je pense qu’il est essentiel pour les jeunes d’avoir une plateforme comme le Cercle, car nous essayons de relever les défis auxquels ils sont confrontés dans le monde actuel, qui est en constante évolution. Les jeunes d’aujourd’hui sont souvent considérés comme la « génération de la crise ». Les jeunes vivent une époque marquée par des crises qui s’enchaînent : la crise financière, une pandémie mondiale et maintenant, pour certains, la réalité de la guerre sur leur continent. Cette situation a poussé de nombreux jeunes à manifester et à militer. Bien que très puissante, la nature conflictuelle de ces actions ne favorise pas toujours un dialogue constructif ou un changement durable.
La nécessité de disposer d’une plateforme de ce type est également renforcée par le fait que cette génération est la première à avoir vécu toute sa jeunesse à l’ère du numérique, qui lui ouvre certes le champ des possibles, mais qui la sature également quotidiennement d’images et de reportages sur les conflits et les guerres. Le Cercle propose une approche différente. C’est un espace dans lequel les compétences numériques de la jeune génération sont non seulement comprises, mais font aussi partie intégrante du fonctionnement de la plateforme, étant donné que le Cercle est dirigé par des jeunes. Il offre l’occasion pour la nouvelle génération de s’engager sur les questions humanitaires tout en adoptant un langage qui fait écho auprès d’elle, ce qui est d’après moi essentiel.
En cultivant un tel environnement orienté vers la recherche de solutions, le Cercle permet aux jeunes de surmonter leur sentiment d’impuissance et leur montre qu’ils sont capables d’agir. Je pense que c’est précisément grâce à leur participation que la confiance s’installe, que l’indignation fait place à l’optimisme et que les médias cessent mettre en avant les conflits pour mettre en lumière les efforts pour consolider la paix. Il est donc essentiel que les jeunes jouent un rôle actif pour sensibiliser à l’idée que la paix ne s’obtient pas facilement.
J’aimerais accueillir notre dernière invitée, Silvia Gelvez, qui a été bénévole au sein de la Croix-Rouge colombienne pendant plus de dix ans. Silvia, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussée à devenir bénévole pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ? De quelles expériences avez-vous été témoin en tant que vice-présidente de la Commission mondiale de la jeunesse de la Fédération internationale de la Croix-Rouge ?
Silvia : Je pense que le fait de vivre dans un pays qui a été affecté par un conflit armé pendant tant d’années m’a profondément impactée. Le fait d’être exposée aux souffrances causées par le conflit a déclenché en moi un profond sentiment d’empathie pour ceux qui ont souffert et, en même temps, comme j’ai été témoin de l’injustice de la guerre, j’ai ressenti le désir de faire changer les choses. J’ai rejoint la Croix-Rouge parce que j’étais convaincue que c’était un bon moyen de faire la différence. J’ai d’abord adhéré parce que je voulais me former aux premiers secours, mais ensuite, après avoir pris connaissance des différents programmes et projets, j’ai eu la certitude que j’étais au bon endroit.
J’ai commencé à faire du bénévolat au sein du groupe pour la jeunesse, dans le cadre du projet de lutte contre la contamination par les armes. Chaque week-end, je me rendais en milieu rural pour faire de la sensibilisation aux risques, en particulier auprès des enfants et des adolescents, afin de faire connaître la réalité des victimes des mines terrestres ou d’autres restes explosifs de guerre et la manière dont leurs droits pouvaient être rétablis.
C’est quelque chose qui m’a vraiment marquée, parce que c’était une question dont on parlait peu dans le pays. J’étais consciente du problème, mais pas la plupart des habitants des villes. J’ai commencé à prendre de plus en plus de responsabilités au sein de l’organisation. Plus de jeunes ont ainsi été amenés à travailler dans la même organisation et à se porter volontaires pour participer aux initiatives de consolidation de la paix.
Je pense également que ce besoin ou ce sentiment de responsabilité à l’égard du développement communautaire vient de mes premières expériences de la guerre, mais aussi des enseignements que la Croix-Rouge m’a transmis. J’ai toujours eu le désir de contribuer à des initiatives à l’échelle locale, mais aussi mondiale. J’ai fini par devenir vice-présidente de la Commission mondiale de la jeunesse et cela m’a apporté un éclairage intéressant, car j’ai découvert que la Commission s’intéresse notamment à la jeunesse qui, partout dans le monde, s’inscrit dans le mouvement visant à créer des stratégies élaborées pour les jeunes qui interviennent en première ligne sur le terrain ou qui sont confrontés à des situations de crise.
C’est quelque chose qui transforme vraiment notre façon de travailler. Ils ne se contentent pas d’échanger sur leurs expériences vécues dans le cadre d’un conflit, mais sensibilisent également d’autres jeunes du monde entier qui ne sont pas nécessairement affectés par un conflit. Le sentiment d’empathie qui se crée autour de tous les jeunes et leur intérêt pour le changement amplifient la caisse de résonnance dont dispose l’organisation pour sensibiliser la population et faire changer les choses.
D’après votre expérience, quelle est la plus-value et l’importance de la diversité des jeunes qui s’engagent sur ces questions dans le secteur humanitaire, en particulier au sein d’un mouvement aussi vaste que celui de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ?
Silvia : Tout d’abord, la diversité favorise la créativité et l’innovation. Elle permet de trouver de nouvelles solutions à des problèmes humanitaires complexes. Partout dans le monde, les jeunes conçoivent de nouveaux programmes, projets et méthodes visant à consolider la paix. En Colombie, après la signature des accords de paix, des jeunes ont mené des activités dans le pays en utilisant la méthode de la communication non violente pour sensibiliser d’autres jeunes.
Ils ont repensé cette méthode et l’ont utilisée pour sensibiliser des anciens combattants de différentes régions qui étaient en voie de réinsertion dans la société. Après tant d’années de conflits et de violence à tous les niveaux de la société, les jeunes ont apporté de nouveaux programmes dans les écoles pour travailler avec les enfants, pour s’assurer que tout le monde était conscient de l’importance de la paix, mais aussi pour sensibiliser à l’importance de mieux comprendre les différences entre les individus.
D’ailleurs, je pense que le secteur humanitaire tire profit de cette diversité qui lui permet de mieux se faire entendre. La participation des jeunes aux processus garantit une représentation plus large, y compris des personnes habituellement mises à l’écart ou ignorées.
Cette inclusivité permet de répondre aux divers besoins et préoccupations des populations affectées et d’apporter une réponse humanitaire plus complète et plus équitable. Pour moi, l’aspect le plus important de la participation des jeunes est leur tendance à mettre l’accent sur des solutions durables à long-terme, en s’attaquant aux causes profondes du problème et en faisant la promotion de solutions qui contribuent à un changement plus global et plus durable.
J’aimerais vous demander ce qui serait selon vous encore nécessaire pour mobiliser davantage de jeunes dans l’action humanitaire. Quels sont les obstacles actuels auxquels vous êtes confrontées et les messages que vous souhaitez faire passer, en particulier ceux qui peuvent influencer le droit et les politiques humanitaires avec lesquels nous devons encore composer aujourd’hui ? Souhaitez-vous commencer, Julie ?
Julie : Oui, bien sûr. Je dirais que pour travailler dans ce secteur, c’est-à-dire sur le droit international plus largement, il faut surmonter certaines barrières socio-économiques. Par exemple, prenons le cas d’une personne issue d’un milieu modeste qui va étudier le droit dans une université publique : elle doit d’abord avoir la chance de pouvoir assister à un cours de droit international, mais aussi d’avoir un professeur qui l’inspire suffisamment pour qu’elle soit convaincue qu’elle peut avoir un avenir professionnel dans ce domaine, ce qui n’est pas évident si personne autour d’elle lui explique que c’est possible. Ensuite, lorsqu’elle commence à entrer dans la sphère professionnelle, elle doit faire des stages, qui sont soit non rémunérés, soit très mal payés. En France, j’ai été payée 600 euros pour trois stages différents, donc si on ne dispose pas d’autres aides, on ne peut pas vivre avec ça. Ensuite, si cette personne souhaite se spécialiser davantage et peut-être s’orienter davantage à l’international, elle devra peut-être faire des études supérieures. En ce qui me concerne, j’ai un Master de droit (LLM) et j’ai eu la chance qu’une banque accepte de m’accorder un prêt que je pourrai rembourser sur plusieurs années. Ce n’est pas le cas de tout le monde. En raison de tous ces facteurs, je pense qu’on perd 70 % des jeunes qui essaient d’entrer dans ce secteur.
Je sais que de nombreux efforts sont déployés par les organisations pour travailler avec les cercles universitaires partout dans le monde et pour réunir des personnes d’horizons différents, mais il y a encore beaucoup à faire.
Le deuxième point que je voudrais aborder concerne également la question de la diversité. Quand on parle de la sphère internationale, de l’extérieur, on a l’impression que les personnes qui prennent les décisions ne nous ressemblent pas. On a l’impression que le droit international et le droit international humanitaire a été conçus par et pour les Européens, pour aider les populations vulnérables d’autres pays, alors qu’en réalité, ce monde évolue. La situation change sur le terrain, car de plus en plus de ressortissants nationaux prennent part à l’action humanitaire à tous les niveaux. Mais quand on regarde les personnes qui sont au sommet, on se dit qu’elles ne nous ressemblent pas. C’est donc aussi, à mon avis, ce qui empêche certaines personnes d’entrer dans le secteur humanitaire.
Kay : Julie met en évidence des points absolument essentiels en mentionnant les obstacles socio-économiques, ainsi que la diversité. Pour renforcer la mobilisation des jeunes dans l’action humanitaire, je dirais que nous devons établir un mécanisme strict de responsabilité en cas de violation des principes humanitaires afin d’entretenir une relation de confiance avec les jeunes. De plus, j’aimerais ajouter que l’éducation, le droit humanitaire et les droits humains devraient être accessibles dès le plus jeune âge, afin de permettre aux jeunes de devenir des promoteurs du droit international bien préparés.
Silvia : Oui, je comprends tout à fait ce point de vue, mais je pense qu’il est important de souligner que la mobilisation des jeunes est généralement considérée comme une simple participation. Lorsqu’on pense à la mobilisation des jeunes, on se dit qu’il s’agit d’inviter des jeunes à prendre part à des activités ou de mettre en place des initiatives dont ils sont les bénéficiaires. Mais en général, les jeunes ne prennent pas part aux processus de prise de décision, à tous les niveaux. Je pense que cet aspect devrait être notre objectif prioritaire, non seulement parce que cela favorise le caractère durable des projets, mais aussi parce que cela représente une autre façon de voir le monde.
Je dis toujours qu’être jeune, c’est voir le monde à travers un prisme différent, et que cette perspective devrait être prise en compte dans tous les changements relatifs au droit et aux politiques humanitaires que nous essayons de mettre en œuvre aujourd’hui. De plus, l’apprentissage entre pairs est essentiel pour susciter des changements. Lorsqu’on voit des personnes qui nous ressemblent, comme cela a été mentionné précédemment, on se sent également plus investi.
J’aimerais à présent revenir sur la question des réseaux sociaux, en commençant peut-être par Kay puisque nous avons entamé cette conversation avec vous tout à l’heure, pourriez-vous nous dire quelles seraient vos recommandations pour communiquer sur le droit international humanitaire, garantir qu’il soit respecté et faire en sorte qu’il garde toute sa pertinence à l’ère de la désinformation, des discours de haine et d’une surcharge de l’information ?
Kay : C’est une question difficile, mais je dirais que pour que le droit garde sa pertinence dans ce brouhaha numérique actuel, nous devrions nous concentrer sur des contenus concis et engageants sur les réseaux sociaux, des outils de sensibilisation interactifs et une narration visuelle convaincante. Concernant les moyens d’atteindre les jeunes, il est important de travailler avec les établissements scolaires mais aussi les influenceurs, c’est-à-dire des jeunes ambassadeurs qui garantissent que le message trouve un écho auprès de la prochaine génération. En résumé, je pense qu’il s’agit de rendre le DIH accessible, compréhensible et interactif pour tous.
Julie : Je suis tout à fait d’accord avec Kay lorsqu’elle dit qu’il faut être concis et présenter les choses dans un format qui peut être facilement retransmis. Je dois dire qu’aujourd’hui, nous sommes à une époque où un très grand nombre de jeunes participent au débat et savent manier les termes du DIH et du droit international. C’est vraiment incroyable. Des habitants de ma ville natale, qui compte 700 habitants, me parlent de proportionnalité. Pour moi, c’est extraordinaire et je pense que le moment est venu de les solliciter, de les intéresser, de les aider à comprendre ces termes et de leur donner accès à l’information. Rien de plus simple, car tout ce qu’ils veulent, c’est dire qu’ils connaissent ce sujet et en parler autour d’eux, alors mobilisons-les. Mobilisons-les pour faire passer le bon message.
Silvia : Je pense qu’en ce qui concerne la pertinence du droit international humanitaire, nous devrions envisager de suivre l’évolution des technologies, ce qui est une bonne chose. Mais nous devons également continuer à mettre l’accent sur la diversité et les différences entre les jeunes du monde entier.
Étant donné que la situation n’est pas la même dans les villes et dans les campagnes, les personnes les plus affectées par le conflit n’ont généralement pas accès aux technologies. C’est là que nous avons le plus besoin du DIH, parce que les jeunes qui vivent dans ces régions sont les plus vulnérables et qu’ils pourraient finir par participer au conflit ou prendre parti parce qu’ils sont davantage exposés au risque d’être recrutés, ou parce qu’un traumatisme intergénérationnel les pousse à choisir un camp. Je dirais donc que nous pouvons utiliser les technologies pour utiliser les médias et communiquer avec les jeunes dans les villes, mais en ce qui concerne les jeunes en milieu rural, nous devons conserver les méthodes traditionnelles.
Je me souviens que lorsque j’ai rejoint la Croix-Rouge, la première formation que j’ai reçue en tant que volontaire portait sur les principes de la Croix-Rouge, son histoire et le droit international humanitaire, que je découvrais pour la première fois. Certains volontaires dans les villages commencent dès leur plus jeune âge à se familiariser avec le DIH. Cela leur donne une perspective différente, et cela nous permet non seulement d’empêcher ces jeunes de participer au conflit, mais aussi de maintenir des liens entre les parties au conflit.
Nous avons observé de nombreuses situations dans lesquelles des jeunes connaissaient une personne qui participait au conflit et ont entamé avec elle une conversation sur le DIH, sur les règles de la guerre et sur la manière dont les civils doivent être protégés, ce qui peut faire une grande différence. En Colombie, par exemple, cela a beaucoup aidé la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge à établir un dialogue avec les communautés et à gagner la confiance des parties. Je pense donc que nous ne devons pas négliger les moyens traditionnels pour faire connaitre le DIH.
J’aimerais vous poser une dernière question, que j’adresse également à nos deux autres invitées. Y a-t-il encore de l’espoir ? À quoi les jeunes d’aujourd’hui et de demain peuvent encore s’accrocher et quels sont les éléments vers lesquels ils peuvent nous orienter ?
Silvia : Absolument, je dirais que oui. On dit que les jeunes perdent espoir parce qu’ils ne voient pas les changements se produire aussi rapidement qu’ils le souhaiteraient. Mais j’ai également constaté une chose extraordinaire en occupant ce poste tourné vers l’international à la Croix-Rouge, en voyant tous les efforts déployés par les jeunes dans le monde entier : toute l’énergie qu’ils mobilisent, toutes ces nouvelles perspectives, et ce désir de construire une communauté et d’impulser des changements : c’est formidable !
Le niveau d’implication, par exemple lorsque les gens font du bénévolat, est incroyable ; des personnes passent tout leur week-end à la Croix-Rouge pour diffuser des messages visant à susciter l’empathie entre les gens, à atténuer les souffrances, et c’est quelque chose qui inspire tout le monde. Lorsque l’on pense à ces jeunes qui occupent des postes de direction, on peut dire que les choses sont en train de changer. Je sais que cela nécessite de passer à la prochaine génération, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie.
Par ailleurs, la résilience de l’être humain et sa capacité à trouver des solutions sont des choses qui m’ont toujours étonnée depuis que je suis toute petite. Donc oui, je pense qu’il y a de l’espoir. Tout à fait.
Kay : Absolument, il y a toujours de l’espoir. Mon expérience au Cercle n’a fait que renforcer cette conviction. Tout d’abord en raison de l’argument que Silvia a souligné, à savoir que nous constatons déjà que les gens se rassemblent et se mobilisent pour faire la différence. Cela montre que la nouvelle génération est non seulement sensibilisée, mais aussi déterminée à relever les défis de ce monde.
La seconde est que l’ère numérique, malgré tous les dangers qu’elle comporte, offre des possibilités sans précédent, comme la possibilité de créer des liens avec des personnes ayant les mêmes idées à l’autre bout du monde et d’utiliser les technologies pour se faire entendre, par exemple. Enfin, les organisations reconnaissent de plus en plus la valeur de l’intégration des jeunes dans les processus de prise de décision.
Aux jeunes d’aujourd’hui et de demain, je dirais, si je peux me permettre, qu’il faut qu’ils vivent leur passion, qu’ils s’accrochent à leur capacité à créer du lien et à innover, et à leur volonté de créer un monde meilleur, parce que ce sont les outils qui permettent de créer le changement que nous souhaitons voir dans le monde et qui nous donnent à toutes et tous une raison de croire en l’avenir.
Julie : Je suis d’accord avec Silvia. Rappelons que le DIH est une branche du droit très récente. Les États pouvaient recourir à la force de manière abusive les uns contre les autres jusqu’en 1945. C’est quelque chose de nouveau. Il y a encore des écarts et des problèmes, bien sûr, mais maintenant qu’ils ne peuvent plus recourir à la force de telle manière, ils doivent se justifier. C’est déjà ça. Concernant les Conventions de Genève, les règles s’appliquant aux conflits armés, qui ont été adoptées à l’unanimité et sont respectées par tous les États, l’année prochaine va marquer leur 75e anniversaire. Le même âge que ma grand-mère, en somme. Imaginez tout ce que nous pouvons faire dans les années à venir, dans les décennies à venir, pour développer le droit. Le droit est établi et il a des règles, mais nous pouvons en demander plus, nous pouvons en faire plus et nous pouvons faire en sorte que les États acceptent d’en faire plus. C’est pour cela que je garde espoir.
J’ai aussi de l’espoir parce qu’il y a beaucoup d’initiatives visant à garantir la diversité non seulement au sein du personnel, mais aussi dans les réflexions et les moyens que nous utilisons. Par exemple, au sein de la Division juridique, certaines personnes travaillent sur les similitudes entre le droit islamique et le DIH. Cela me donne de l’espoir, car nous constatons qu’une grande partie du monde applique déjà des règles et des lois similaires. Nous pouvons non seulement nous en servir pour instaurer un dialogue, mais aussi pour enrichir cette branche du droit.
Enfin, je dirais que ce qui me donne de l’espoir, c’est le fait de travailler ici au CICR, de pouvoir partager mon expérience avec des collègues extraordinaires, qu’il s’agisse de mes collaborateurs ou de mes superviseurs, qui sont toutes et tous là pour défendre la protection des victimes des conflits armés ; ce sont des gens remarquables. Tant de personnes exceptionnelles rassemblées pour travailler à la réalisation d’un même objectif, cela me donne également de l’espoir.
Cet article a été initialement publié en anglais le 1er février 2024.
Voir aussi :
- Cordula Droege, Elizabeth Rushing, Israel et les territoires occupés : comment s’applique le droit international humanitaire ?, 31 janvier 2024
- Stephen Kilpatrick, Philippe Cholous, Susan Mwanga, Réduire les dommages lors d’opérations militaires de sécurité, 28 mars 2024.
- Jérôme Marston, Protéger l’éducation contre des attaques de groupes armés non étatiques, 25 octobre 2023.







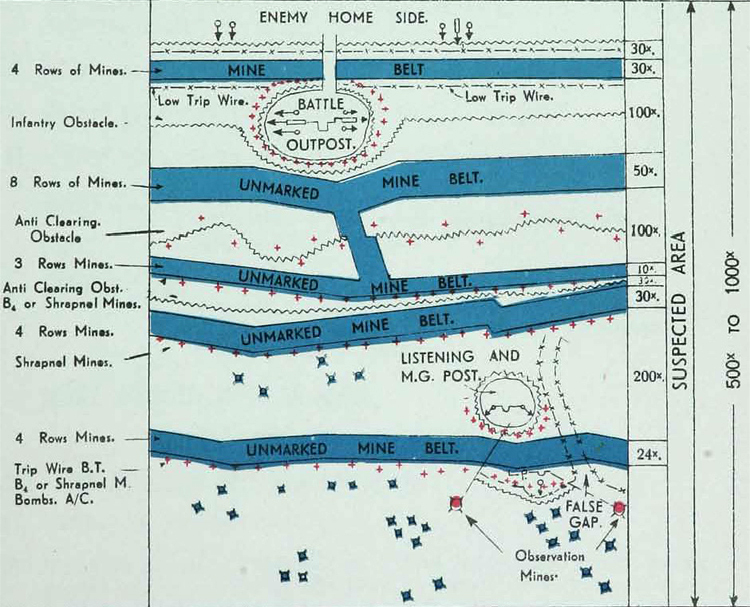

Comments