Dans les villes de Gaza, du Soudan et de l’Ukraine, les guerres en milieu urbain changent irrémédiablement la vie des enfants. Pourtant, malgré le nombre d’enfants affectés et la nature de plus en plus urbanisée des conflits, les spécialistes et les décisionnaires ne comprennent pas suffisamment la nature spécifique des dommages causés aux enfants. Pour combler cette lacune, le CICR a publié en 2023 un nouveau rapport intitulé L’enfance sous les décombres : Les conséquences humanitaires de la guerre en milieu urbain sur les enfants – qui s’appuie sur des publications existantes, 52 entretiens avec des experts et l’expérience directe de l’organisation.
Dans cet article, trois des auteurs et autrices du rapport exposent comment la guerre en milieu urbain affecte les enfants au travers de huit aspects négligés et présentent une série de recommandations juridiques, politiques et opérationnelles que les États, les groupes armés non étatiques et les humanitaires pourraient mettre en œuvre pour que la protection des enfants passe d’un appel à la mobilisation dans les médias au statut de priorité politique.
Rares sont les jours sans que les médias ne montrent des images saisissantes de la guerre qui dévaste la vie des enfants dans les zones de conflit urbain. Ces images, bien que percutantes, ne font qu’effleurer les impacts complexes et profonds que la guerre en milieu urbain a sur des millions d’enfants. Il y a la destruction immédiate, la violence et le chaos, mais il y a aussi les conséquences de la guerre urbaine, durables et invisibles, une fois que l’attention médiatique s’est déplacée.
Nous examinons ici huit aspects souvent négligés par lesquels la guerre en milieu urbain affecte les enfants, en nous appuyant sur l’analyse du récent rapport du CICR, L’Enfance sous les décombres– Les conséquences humanitaires de la guerre en milieu urbain sur les enfants. En offrant une compréhension plus complète des nombreux types de préjudices interconnectés que les enfants subissent lors des guerres en milieu urbain, le rapport vise à orienter une réponse humanitaire mieux adaptée et appelle les parties au conflit à redoubler d’efforts pour prévenir les dommages raisonnablement prévisibles infligés aux enfants lors des opérations militaires.
1. Les enfants ont des modes de vie particuliers dans les villes, qui changent pendant les conflits armés
Les enfants vivent les conflits en milieu urbain de manière différente des adultes. Dans le labyrinthe d’une ville en guerre, des actes simples comme sortir pour jouer, acheter de la nourriture, ramasser du bois ou aller à l’école peuvent devenir dangereux. Les enfants sont généralement plus petits que les adultes et les forces armées connaissent souvent moins les lieux qu’ils fréquentent, leur présence peut ainsi être plus facilement ignorée ou négligée lors des activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Leurs routines précédentes et leurs façons de se déplacer dans la ville, souvent centrées autour des écoles, des terrains de jeux et des maisons, sont perturbées, les exposant à des risques imprévus et les poussant vers des endroits qu’ils ne fréquentaient pas auparavant. Ils sont blessés ou tués par des engins explosifs, des bâtiments qui s’effondrent, des mines terrestres ou des tireurs embusqués.
Les services essentiels spécifiques aux enfants – tels que les unités de santé maternelle et pédiatrique, ainsi que les établissements éducatifs – souffrent également : lors de la planification et de la conduite de leurs opérations militaires, les parties belligérantes peuvent sous-estimer l’importance des infrastructures civiles essentielles à la vie et au développement des enfants.
2. La curiosité naturelle des enfants et leur besoin inné de jouer et d’explorer les exposent à de graves menaces dans des environnements dangereux
Le rapport Landmine and Cluster Munition Monitor de 2023 indique que les enfants représentaient 49% des victimes recensées (lorsque l’âge était connu) des mines terrestres et des restes explosifs de guerre (REG), et 71% des victimes de restes de sous-munitions (lorsque l’âge et le type d’arme étaient connus). La curiosité naturelle des enfants peut les exposer à des risques. Ils peuvent être tentés de ramasser et de jouer avec des objets colorés ou captivants, ou d’explorer des bâtiments abandonnés dans des environnements de guerre en milieu urbain Ces bâtiments endommagés peuvent s’effondrer autour d’eux ou dissimuler des mines terrestres et des restes explosifs de guerre, provoquant la mort ou des blessures dévastatrices en un instant.
De plus, lors d’un bombardement ou d’une explosion, les adultes comprennent souvent la nécessité de se mettre à l’abri en raison du risque d’explosions secondaires ou d’effondrements de bâtiments, alors que les enfants peuvent ne pas le savoir. Qui plus est, ils risquent de céder à la panique, d’être livrés à eux-mêmes ou de chercher refuge ailleurs dans la ville, ce qui les expose au risque d’être séparés de leur famille.
3. Les armes explosives infligent des dégâts particulièrement sévères aux corps des enfants
Les mêmes armes explosives qui blessent ou mutilent un combattant adulte peuvent plus facilement tuer un enfant. Avec leur taille plus petite et leur physiologie particulière – un poids plus faible, des parois abdominales proportionnellement plus fines, des organes internes relativement plus grands, moins de sang et un torse plus près du sol – les enfants sont plus susceptibles de mourir des suites d’une explosion. Ces caractéristiques physiques signifient que les enfants qui survivent à une explosion ont plus de risques que les adultes d’avoir des éclats d’obus dans la tête, le cou, les membres supérieurs et le torse. Les effets des explosions sur les enfants peuvent également entraîner la perte de membres ou des déficiences sensorielles, entrainant des conséquences durables sur leur santé et un handicap qui redéfinissent l’avenir et la transition vers l’âge adulte d’un enfant.
Fournir des soins aux enfants après un incident lié à une explosion représente également un défi. Les enfants peuvent être affaiblis par la malnutrition, l’exposition à des conditions d’hygiène précaires et à des sources d’eau contaminées ou insuffisantes. Ils ont généralement plus de besoins de santé et nécessitent davantage d’interventions chirurgicales que les adultes après une explosion. De plus, les soins sont compliqués par le manque d’expertise pédiatrique en situation d’urgence (bien que des ressources précieuses, comme le Manuel pédiatrique de terrain pour les blessures par explosion balistique, soient disponibles pour les professionnelles de santé).
4. L’impact de la guerre dans les villes peut laisser une empreinte significative sur la santé mentale et le bien-être des enfants, à court et à long terme
Les recherches indiquent que dans les zones affectées par des conflits, plus de 22% des personnes souffrent de troubles mentaux, soit trois fois la moyenne mondiale. Pour les enfants, le stress intense causé par la guerre peut altérer la structure de leur cerveau en développement, contribuant potentiellement à des problèmes cognitifs et émotionnels, tels que les troubles anxieux, le trouble de stress post-traumatique et la dépression. Les enfants n’oublient jamais la perte de leurs animaux de compagnie, de leur maison d’enfance, de leurs amis et voisins. Ils subissent des traumatismes en étant témoins ou victimes de violences, de blessures, de décès, de séparations familiales ou des effets en cascade des difficultés économiques.
Les enfants ayant vécu des conflits ou des déplacements signalent des insomnies, du stress, de l’anxiété, des crises de panique, du chagrin, de l’énurésie nocturne, la peur des bruits forts et des cauchemars. La présence d’avions ou de drones peut déclencher la peur et des cris chez les enfants, ces sons étant associés aux bombardements. Dans le pire des cas, et sans soutien, les enfants affectés peuvent envisager le suicide ou se livrer à des actes d’automutilation, reflétant l’impact psychologique profond de la vie dans une zone de conflit.
5. L’accès à l’éducation est gravement compromis
La guerre en milieu urbain nuit gravement à l’éducation des enfants de bien d’autres manières que par les attaques endommageant ou détruisant les écoles, ou causant la mort d’élèves et du personnel éducatif. Même lorsque les enseignants restent sur place et que les écoles peuvent rester ouvertes, il peut être impossible d’y accéder en toute sécurité. Les conflits perturbent les services essentiels nécessaires au fonctionnement des écoles, tels que l’électricité, l’eau, le chauffage et les transports, compliquant encore davantage l’accès, en particulier pour les enfants en situation de handicap. La pénurie de ressources, les salles de classe et les infrastructures endommagées, ainsi que le déplacement des enseignants, perturbent également le processus d’apprentissage.
Pour les jeunes enfants, les activités de garde sont également perturbées. Pour les enfants plus âgés, l’interruption des calendriers d’examens et l’impact sur le taux de transition entraînent des conséquences à long terme, affectant leurs résultats scolaires, ainsi que leur parcours éducatif et leurs opportunités futures. Par exemple, l’OCDE estime qu’une année de scolarisation manquée entraîne une réduction des revenus de 7,7% ; par ailleurs, chaque année supplémentaire de scolarisation est systématiquement associée à un taux d’emploi plus élevé.
Les défis liés à la mise en œuvre de l’apprentissage à distance ou hybride, à la création d’espaces temporaires et à la gestion sécurisée pour les enfants déplacés ou restés sur place peuvent s’avérer complexes et administrativement lourds – notamment dans les contextes où les infrastructures éducatives sont détruites et où la connectivité internet ou radio est peu fiable. Cependant, ces solutions peuvent constituer les seules options restantes pour offrir une éducation capable de transformer des vies.
6. Les risques pour les enfants en situation de handicap sont aggravés :
Les enfants en situation de handicap sont souvent affectés de manière disproportionnée par la guerre en milieu urbain. La mobilité est réduite pour tous les enfants, mais ceux qui sont en fauteuil roulant ou qui souffrent de déficiences sensorielles, comme des troubles auditifs ou visuels, font face à des obstacles encore plus importants. Par exemple, lorsque les ascenseurs sont hors service, que les routes sont bloquées ou que leurs dispositifs d’assistance sont endommagés. Les enfants atteints de troubles auditifs ou visuels peuvent ne pas être en mesure d’entendre les avertissements ou de percevoir de nouveaux dangers, tels que des bâtiments endommagés ou des points de contrôle bloquant des chemins auparavant sûrs.
L’aide destinée aux enfants en situation de déficience intellectuelle risque d’être réduite, voire inexistante. En outre, les professionnels de santé et de la rééducation, essentiels à leur prise en charge, pourraient être évacués, déplacés ou se trouver dans l’impossibilité de se rendre à leur travail. Lors de la reconstruction d’une ville après un conflit, des investissements conséquents sont indispensables pour développer les services techniques, rendre les infrastructures accessibles et renforcer le soutien aux personnes en situation de handicap.
7. Les expériences des enfants sont souvent genrées
L’expérience des enfants de la guerre en milieu urbain tend à différer en fonction du sexe et du genre. Les recherches montrent que les garçons sont plus susceptibles d’être directement touchés par les armes explosives, les mines terrestres et les restes explosifs de guerre (REG), car ils sont plus souvent dans les espaces publics. Ils peuvent faire des courses pour la famille, rencontrer des amis, collecter des métaux usagés ou fouiller dans des bâtiments endommagés qui peuvent être contaminés par des armes. Les garçons peuvent aussi être davantage pris pour cible par des acteurs armés, car ils sont plus susceptibles d’être perçus comme une menace pour la sécurité que les filles.
Les filles subissent également des conséquences spécifiques de la guerre en milieu urbain dues à leur genre, dans le contexte des inégalités de genre présentes dans la plupart des sociétés. Les écarts de genre dans l’accès à l’éducation se creusent en situation de déplacement ; dans certains contextes, les filles et les femmes font face à des obstacles liés au genre pour accéder aux soins de santé, notamment à un manque de praticiennes qualifiées. Bien que la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSBG) touche à la fois les filles et les garçons, les filles en sont davantage victimes.
8. Les déplacements et les séparations familiales sont fréquents
Les dynamiques de la guerre en milieu urbain, avec des déplacements constants des troupes et des lignes de front, augmentent le risque que les enfants soient séparés de leurs familles. Les enfants et les familles sont souvent forcés de quitter leurs foyers, soit en raison des conséquences directes de la fuite de la violence, soit en raison de conséquences indirectes comme les fermetures d’écoles et le manque d’accès aux services essentiels. La destruction causée par la guerre en milieu urbain entrave également les retours en toute sécurité et dans la dignité, laissant les enfants des familles déplacées grandir dans un état d’incertitude.
Les enfants peuvent perdre rapidement le contact avec leur famille à cause des évacuations, du besoin de se mettre à l’abri des attaques, de la confusion liée aux déplacements internes ou encore lors du franchissement de frontières internationales. Ceux qui sont en situation de handicap et/ou placés dans des institutions, comme des orphelinats, peuvent être négligés dans les plans d’évacuation, ce qui accroît leur vulnérabilité. Les déplacements peuvent réduire l’accès des enfants aux programmes de vaccination et à d’autres interventions médicales si nécessaire, entraînant des maladies et des handicaps évitables qui peuvent avoir des conséquences sanitaires à vie pour l’enfant, sa famille et la communauté.
Recommandations : Mesures nécessaires pour prévenir et répondre aux dommages causés aux enfants
Les États, les parties aux conflits armés et les acteurs humanitaires font des choix quant à ce qu’ils priorisent, qui ils ciblent et comment ils allouent leurs ressources lorsqu’ils planifient et mènent leurs activités en temps de guerre. Bien que les enfants soient souvent évoqués dans les communications publiques et les forums multilatéraux, ils ne reçoivent pas toujours l’attention particulière que leur vulnérabilité exige lors de la prise de décision par les organisations. Le chapitre 4 de L’enfance sous les décombres appelle à un changement face à cette situation actuelle inadéquate, avec des recommandations adaptées à chaque acteur, résumées ici brièvement.
Le droit international et les normes destinés à assurer la protection les enfants dans les conflits armés sont détaillés et solides, mais ils sont très souvent bafoués et oubliés. Une partie du problème réside dans le fait que de nombreux États ont laissé un contraste se créer entre leurs engagements internationaux et leurs cadres juridiques nationaux. Les États devraient mettre à jour leurs cadres juridiques nationaux pour qu’ils correspondent à leurs obligations internationales existantes, tout en adoptant et en mettant en œuvre des normes plus exigeantes – notamment les Principes et Engagements de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, les Déclarations sur la sécurité dans les écoles et la Déclaration politique sur le renforcement de la protection des civils face aux conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées (Déclaration politique EWIPA).
Les ministères concernés et autres organismes publics devraient élaborer des mesures préparatoires visant à protéger les enfants et à réduire les risques les concernant en cas d’hostilités. Ces mesures peuvent inclure des plans d’évacuation adaptées aux besoins des enfants (y compris des abris et des messages conçus pour les prendre en compte) ainsi que des politiques garantissant la continuité des services de santé et d’éducation pour les enfants, en prévision des perturbations causées par les conflits. Les enfants en détention ne doivent pas être oubliés : les mesures visant à réduire le nombre d’enfants détenus pour atténuer les risques liés aux crises ont démontré leur efficacité en situation d’urgence. En effet, l’UNICEF estime que plus de 45 000 enfants ont été libérés pendant la pandémie de COVID-19, en partie grâce à de bonnes mesures de préparation.
Les acteurs armés devraient élaborer une doctrine spécifique et/ou adapter les doctrines existantes ainsi que les procédures opérationnelles standard afin de traiter explicitement la protection des enfants dans les environnements urbains. Ils devraient intégrer une sensibilisation aux besoins spécifiques des enfants et aux risques auxquels ils sont confrontés dans la formation militaire. Ceux qui participent à la planification des opérations militaires en milieu urbain devraient tenir compte de la situation particulière des enfants lors de l’examen des options visant à éviter et/ou à atténuer les dommages causés aux civils. Parmi les mesures utiles figurent la mise en place de systèmes de suivi des pertes civiles, ventilés par âge et par sexe dans la mesure du possible, ainsi que l’inclusion de conseillers spécialisés en protection de l’enfance dans la planification.
Enfin, les acteurs humanitaires devraient également anticiper de manière plus systématique les risques spécifiques auxquels les enfants sont exposés pendant les hostilités en milieu urbain. Cette démarche renforcerait leur capacité à prévenir et à réduire les dommages causés aux enfants, conformément aux directives existantes pour travailler avec les enfants en situation d’urgence (notamment les Standards minimums pour la protection de l’enfance).
D’autres recommandations exposées dans le rapport encouragent une meilleure collecte et ventilation des données selon le genre, l’âge et le handicap, ainsi que le respect de la dignité des enfants dans les représentations médiatiques, en évitant leur diffusion si elle ne sert pas leur intérêt supérieur.
Conclusion
Les ravages infligés aux enfants par la guerre en milieu urbain rappellent cruellement la nécessité de faire preuve de retenue dans les opérations militaires. Parmi les nombreuses causes de désespoir, certaines perspectives d’amélioration de la protection de la vie des enfants émergent. L’une des avancées les plus significatives est l’adoption de la Déclaration politique sur l’utilisation des armes explosives dans les zones peuplées (EWIPA) en 2022, désormais approuvée par 87 États. La première conférence internationale, qui s’est tenue à Oslo en 2024 pour évaluer la mise en œuvre de cette déclaration, a offert une plateforme pour envisager des mesures concrètes visant à élever la sécurité et le bien-être des civils, y compris des enfants dans les zones de conflit, au rang de priorités. La protection des enfants a été mentionnée tout au long des différentes sessions par les États et les organisations humanitaires, avec un accent particulier sur la protection des infrastructures essentielles utilisées par les enfants ainsi que sur les actions spécifiques entreprises par les forces armées pour éviter, réduire et atténuer les dommages causés aux civils, notamment aux enfants. Les recommandations connexes du CICR à la Conférence soulignent l’importance de prendre des mesures particulières pour les enfants, dans les recommandations 2.10.1, 5.4 et 5.9.
En conclusion, les images omniprésentes dans les médias montrant des enfants confrontés à la guerre en milieu urbain immortalisent certains des moments les plus vulnérables et traumatisants pour eux-mêmes et leurs proches. Bien que ces images puissent sensibiliser l’opinion, il est essentiel d’éviter de réduire ces enfants à de simples symboles d’un conflit, au détriment de leurs histoires personnelles ainsi que du soutien immédiat et durable dont ils ont besoin.
Il est crucial de trouver un équilibre entre la nécessité de sensibiliser et la protection, la vie privée et la dignité auxquelles les enfants ont intrinsèquement droit. La meilleure manière d’y parvenir est que les États, les porteurs d’armes, les acteurs humanitaires, les communautés, les familles et les enfants eux-mêmes analysent et partagent ce à quoi sont spécifiquement confrontés les enfants dans les guerres en milieu urbain. Cette analyse implique de prendre en compte de manière globale les nombreux facteurs complexes et croisés qui conduisent à des dommages ou à une protection, de mettre en œuvre des mesures visant à minimiser et à atténuer ces préjudices, et de soutenir le rétablissement à travers des approches qui intègrent les enfants et leurs besoins à chaque étape du processus.
Cet article a été initialement publié en anglais le 22 août 2024. Il a été traduit par Raphaëlle Duhamel, en Master 1 de Traduction spécialisée multilingue de l’Université de Grenoble Alpes, en France.
Voir aussi :
- Abby Zeith, Pris au piège des conflits : l’état de siège et l’encerclement en milieu urbain, 17 octobre 2024
- Daniel Palmieri, Histoire des villes en guerre, 13 octobre 2021.
- Jerome Marston, Protéger l’éducation contre les attaques de groupes armés non étatiques, 25 octobre 2023.



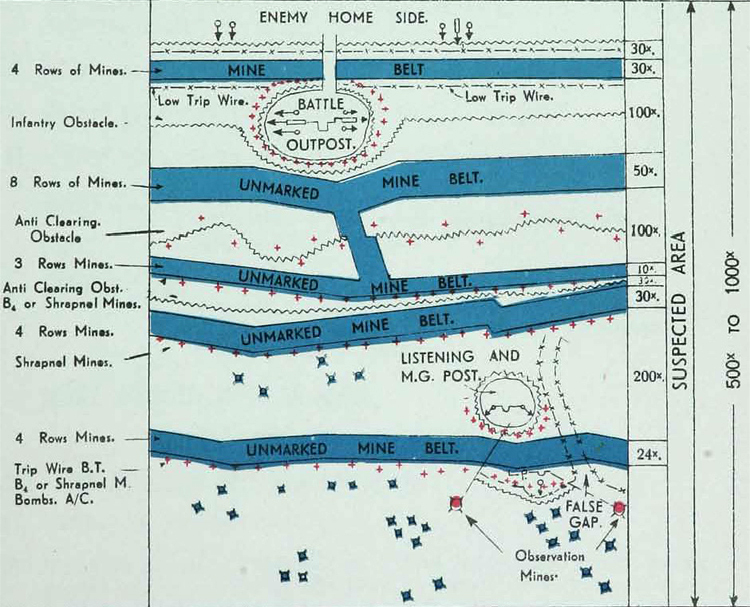

Comments