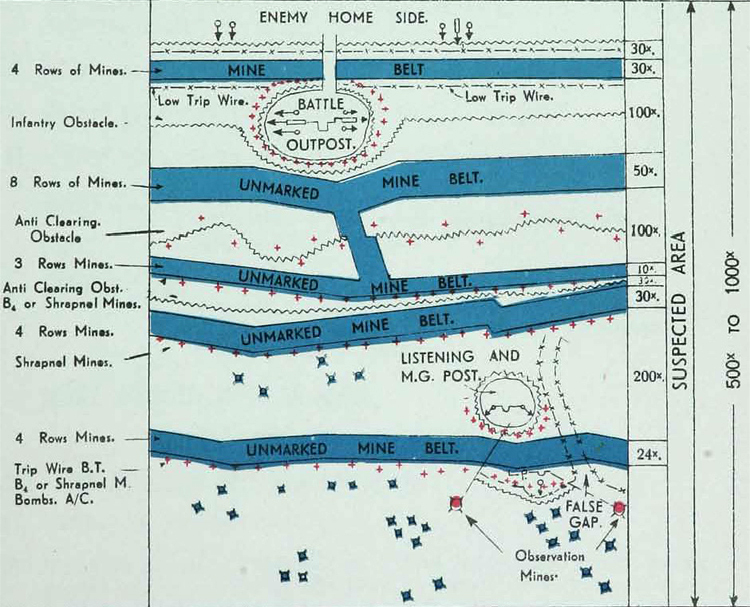Le retrait sans précédent de la Lituanie de la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention d’Oslo) est devenu effectif début mars. Dans la foulée, plusieurs États remettent ouvertement en question leur adhésion de longue date à d’autres traités humanitaires, comme la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (Convention d’Ottawa). Cette tendance s’inscrit sur fond de montée des tensions internationales et des préoccupations sécuritaires, tant en Europe que dans le reste du monde. Elle intervient dans un contexte où les normes humanitaires fondamentales sont largement bafouées, comme en témoignent les ravages considérables causés par les conflits actuels.
Dans cet article, Cordula Droege, conseillère juridique en chef du CICR, et Maya Brehm, conseillère juridique du CICR, expliquent que les récentes remises en cause de la Convention d’Ottawa sont le reflet de menaces plus globales qui pèsent sur les protections vitales offertes par le droit international humanitaire (DIH). Elles font valoir que les motifs invoqués pour justifier le recours aux mines antipersonnel sont souvent déconnectés des réalités sur le champ de bataille et ne tiennent pas compte des terribles conséquences de ces armes particulièrement perfides. Les autrices montrent également comment les efforts visant à contourner ou quitter la Convention d’Ottawa sapent les principes fondamentaux du DIH et fragilisent l’état de droit international. L’article conclut par un appel à renforcer les normes humanitaires, garde-fous indispensables pour préserver l’humanité dans la guerre.
Dans un contexte marqué par le conflit armé international entre la Russie et l’Ukraine, les débats se sont intensifiés chez plusieurs États quant à une éventuelle sortie de certains traités humanitaires emblématiques, parmi lesquels la Convention d’Ottawa. Ces discussions font suite au retrait sans précédent de la Lituanie de la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention d’Oslo) en septembre dernier, lequel a pris effet ce mois-ci. Autre initiative inédite, l’annonce faite par les États-Unis à l’automne dernier de leur intention de transférer des mines antipersonnel à l’Ukraine, annonce qui a relancé la polémique autour de l’utilité, l’acceptabilité et la licéité de ces armes que l’on croyait à jamais reléguées au passé.
Pour protéger les civils et les autres victimes de la guerre – en Europe et ailleurs –, il est essentiel de renforcer les raisons humanitaires qui sont à l’origine des traités tels que la Convention d’Ottawa et de rejeter l’idée que le respect du DIH puisse être subordonné à des considérations en matière de sécurité ou de défense, aussi exceptionnelles que puissent être les circonstances.
Les conséquences humanitaires dévastatrices et durables des mines antipersonnel
Chaque année, les mines antipersonnel et les restes explosifs de guerre (REG) font des milliers de victimes et détruisent des moyens de subsistance. Les personnes qui survivent à l’explosion d’un de ces engins – pour la plupart des enfants – souffrent de blessures et de traumatismes d’une extrême gravité, et beaucoup d’entre elles ne peuvent plus jamais remarcher. En Ukraine, par exemple, les mines et les REG sont parmi les principales causes de pertes civiles, en particulier sur les lignes de front et dans les régions disputées.
Mais les effets néfastes ne s’arrêtent pas là : la contamination par les armes ne dévoile toute son étendue qu’avec le temps. Du Cambodge à la Croatie, les mines antipersonnel attendent imperturbablement pendant des décennies, enfouies sous la poussière et les gravats, prêtes à mutiler des déplacés peu prudents qui rentrent chez eux après la fin des hostilités, des soldats de la paix déployés le long d’une ligne de contrôle, des bergers gardant leurs troupeaux ou des enfants jouant à l’extérieur.
Depuis son entrée en vigueur il y a 26 ans, la Convention d’Ottawa a permis de réduire drastiquement le nombre de personnes tuées ou blessées par les mines antipersonnel. Elle a également contribué à promouvoir la destruction de plusieurs millions de ces engins stockés dans le monde ainsi que le déminage de vastes étendues de terre (30 États parties précédemment contaminés se sont déclarés exempts de mines), à attirer l’attention sur le sort des survivants et à mobiliser d’importants moyens pour la lutte antimines.
Ce nonobstant, ces dernières années, le nombre de victimes a dramatiquement augmenté. Selon le rapport annuel de l’Observatoire des mines, les mines antipersonnel ont fait à elles seules 833 victimes en 2023 – un record depuis 2011. D’après l’Observatoire, cette hausse est imputable en grande partie à l’utilisation massive de ces engins dans le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine (ainsi qu’aux nouvelles utilisations par l’Iran, le Myanmar et la Corée du Nord) et à l’emploi de mines improvisées, principalement par des groupes armés non étatiques. En 2023, des victimes de mines improvisées ont été enregistrées dans 23 États, si bien que c’est ce type de mine/REG qui cause le plus de victimes depuis plusieurs années.
Si le nombre de victimes varie d’une année à l’autre, les modalités des dommages infligés par ces armes restent inchangées et ont été amplement documentées depuis la crise mondiale des mines terrestres des années 1990. Les civils – ceux-là même qui devraient être protégés contre les effets de la guerre – continuent de payer le plus lourd tribut ; en 2023, ils représentaient 84% des victimes de mines/REG, dont beaucoup d’enfants.
Les conséquences humanitaires des mines antipersonnel sont dévastatrices, mais cela n’a rien de surprenant. Ces armes sont « déclenchées par les victimes », ce qui signifie qu’elles sont « conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes », pour reprendre la définition juridique (art. 2, al. 1, de la Convention d’Ottawa et, en des termes pratiquement identiques, art. 2, al. 3, du Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques). Les mines antipersonnel ne peuvent pas faire la distinction entre un soldat et un enfant. Elles ont des effets indiscriminés et, de l’avis de certains, elles sont même de nature à frapper sans discrimination et partant interdites par le DIH. L’obligation de faire la distinction entre civils et combattants est l’un des principes fondamentaux du DIH sur lequel repose l’interdiction juridique des mines antipersonnel prononcée en 1997 (Préambule de la Convention d’Ottawa).
La Convention d’Ottawa est unanimement reconnue comme une réussite et bénéficie d’un large soutien international – plus de trois quarts des États membres de l’ONU (164 États parties en mars 2025 [1]) sont tenus de respecter ses dispositions, tandis que d’autres États et 54 groupes armés non étatiques ont formellement adhéré à ses normes et se sont engagés à les respecter. Pas plus tard qu’en novembre 2024, les États parties à la cinquième Conférence chargée de l’examen de la Convention, qui s’est tenue à Siem Reap-Angkor, au Cambodge, ont réaffirmé leur « indéfectible détermination » à mettre fin au fléau des mines antipersonnel.
En dépit de cette volonté à l’échelon mondial, certains arguments concernant les « avantages » procurés par les mines antipersonnel ont refait surface ces derniers mois. D’aucuns laissent entendre que certains de ces engins pourraient ne pas tomber sous le coup de l’interdiction établie par la Convention d’Ottawa, tandis que les arguments justifiant leur emploi et leur prolifération gagnent en popularité dans certains milieux.
L’utilité militaire limitée des mines antipersonnel est sans commune mesure avec leurs conséquences humanitaires dévastatrices
Les récentes déclarations sur les avantages militaires offerts par les mines antipersonnel en matière de défense nationale ou de dissuasion tranchent nettement avec les efforts déployés depuis des décennies par les États et d’autres acteurs en vue d’éliminer ces engins, conformément à leurs engagements au titre du DIH, des droits des personnes en situation de handicap et des Objectifs de développement durable.
Une étude approfondie diligentée par le CICR en 1996 – et validée par des officiers militaires de 19 pays ayant pour la plupart une expérience directe de l’emploi des mines – est arrivée à la conclusion que ces armes n’ont qu’une « utilité militaire limitée » et que celle-ci est « sans commune mesure avec les terribles conséquences humanitaires qu’elles engendrent dans les conflits actuels ». Passant en revue 26 conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, l’étude n’a recensé aucune donnée probante permettant d’étayer les affirmations selon lesquelles les mines antipersonnel seraient indispensables ou d’une grande utilité militaire.
Outre les effets dévastateurs de ces armes sur le plan humanitaire et après la fin des conflits, l’étude a établi que :
- les champs de mines peuvent être franchis relativement rapidement à l’aide de matériel de déminage, ils ne sont efficaces que lorsqu’ils sont protégés par une couverture de feu et ils n’ont pas permis faire obstacle aux missions d’inflitration militaire dans la pratique ;
- la mise en place, la surveillance, l’entretien et le nettoyage des champs de mines sont des tâches de longue haleine, coûteuses et dangereuses ; et
- l’utilisation de mines antipersonnel fait des victimes également dans son propre camp et parmi les forces alliées, tout en limitant la flexibilité tactique.
L’étude a par ailleurs révélé que, sur le champ de bataille, il est extrêmement difficile – même pour des armées professionnelles – d’utiliser les mines antipersonnel d’une manière conforme à la doctrine militaire traditionnelle et aux obligations énoncées par le DIH (concernant la signalisation, la cartographie, etc.), et que cela a rarement été le cas dans la pratique. Elle a également souligné que les mines antipersonnel mises en place à distance (par exemple, celles qui sont lancées par l’artillerie) posent de sérieux défis en termes de marquage et d’enregistrement de leur emploi et soulèvent des préoccupations particulières en ce qui concerne la protection des civils.
En décembre 2004, un groupe d’experts militaires de haut rang a réaffirmé et actualisé les conclusions de l’étude. Il a mis en avant le fait que d’autres moyens étaient disponibles (par exemple, pour empêcher l’accès à certaines zones, structurer le champ de bataille ou prévenir l’enlèvement de mines antivéhicule) et que l’évolution de la guerre, conjuguée aux progrès des technologies militaires, avait rendu les mines antipersonnel superflues.
Depuis lors, les avancées opérées en matière de technologies antimines et l’essor de la guerre en réseau n’ont fait qu’asseoir ces conclusions, qui ont été par ailleurs confirmées par les déclarations faites récemment par des responsables militaires, notamment par le commandant des forces armées lettones (janvier 2024) et par le commandant des forces de défense estoniennes (décembre 2024).
La Convention d’Ottawa interdit toutes les mines antipersonnel, mais pas les autres mines ou munitions
D’aucuns prétendent que certains types de mines antipersonnel pourraient ne pas être soumis à l’interdiction établie par la Convention d’Ottawa ou ne pas représenter de véritable menace pour les civils. Ces arguments font parfois référence, sans donner plus de détails, à des progrès technologiques liés aux mines (les mines « intelligentes »). Plus généralement, ils évoquent des mines antipersonnel dites « non persistantes », équipées de dispositifs d’autodésactivation et d’autodestruction – des mécanismes qui, selon certains États, « réduiraient les risques humanitaires à un niveau acceptable ».
En dépit de leur nom, les mines « non persistantes » représentent bel et bien une menace. Une fois activées, leurs effets sont tout aussi indiscriminés que ceux de n’importe quelle autre arme déclenchée par la victime. De surcroît, inévitablement, une partie d’entre elles ne s’autodétruira pas comme prévu – et sur le champ de bataille, le taux d’échec sera probablement plus élevé que dans les conditions de test sous contrôle. Lorsqu’elles sont mises en place à distance, les mines antipersonnel peuvent être déployées en grandes quantités, ce qui signifie que même un taux de dysfonctionnement relativement bas peut conduire à une contamination de grande ampleur. Du point de vue du déminage humanitaire, toutes les mines antipersonnel – y compris celles dites « non persistantes » – doivent être considérées comme dangereuses, du moment que leur coût humain et économique persiste bien au-delà de leur usage prévu.
Pour ce qui est de la licéité : la Convention d’Ottawa interdit toutes les mines antipersonnel, sans exception. Sa définition d’une mine antipersonnel (art. 2, al. 1, de la Convention d’Ottawa) n’établit pas de différence en fonction de la durée pendant laquelle l’engin reste activable par la victime. La question des mines « non persistantes » a fait l’objet de débats approfondis lors des travaux menés en 1996 dans le cadre de l’amendement du Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques, qui a précédé l’adoption de la Convention d’Ottawa. Et il ne fait aucun doute que l’intention était que ces mines soient soumises à l’interdiction générale édictée par le traité.
En revanche, la Convention d’Ottawa n’interdit pas les autres types de mines. Elle ne s’applique pas aux mines navales ni aux mines antivéhicule, y compris aux mines antichar traditionnelles (mécaniques) et à celles plus modernes dites « intelligentes » ou « en réseau ». L’utilisation de ces dernières est régie par le Protocole II de 1980 et par le Protocole II amendé de 1996 à la Convention sur certaines armes classiques, le cas échéant, ainsi que par les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités et aux mines terrestres (Étude sur le DIH coutumier, règles 81-83).
La Convention d’Ottawa n’interdit pas non plus les munitions explosives à détonation commandée, comme celles déclenchées par un combattant au moyen d’un fil de mise à feu ou par radiofréquence. Ces armes sont parfois qualifiées de « mines » dans le langage courant, comme dans le cas des mines Claymore américaines, ou des Jäämiina (mines à glace) finlandaises, qui ont joué un rôle déterminant durant la Guerre d’Hiver (1939-1940). Cependant, lorsqu’elles sont utilisées en mode détonation commandée, ces munitions ne répondent pas à la définition juridique d’une « mine » (art. 2, al. 1, du Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques ; art. 2, al. 1, du Protocole II amendé à la Convention sur certaines armes classiques). Partant, leur emploi est régi en application des restrictions prévues pour les « autres dispositifs explosifs » dans le Protocole II de 1980 et dans le Protocole II amendé de 1996 à la Convention sur certaines armes classiques, le cas échéant, ainsi que par les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités et aux armes.
La Convention d’Ottawa s’applique en toutes circonstances, y compris en temps de guerre
Dans le contexte du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, les récents arguments en faveur d’un retrait de la Convention d’Ottawa portent en grande partie sur la licéité et la légitimité de l’usage de la force pour se défendre contre l’agression d’un adversaire. Les partisans de ce point de vue soutiennent que l’utilisation des mines antipersonnel et le retrait du traité se justifient par les circonstances exceptionnelles – soulignant que les auteurs de la Convention n’avaient pas anticipé ce cas de figure et que le respect des restrictions qu’elle impose défavorise les États lorsqu’ils sont confrontés à un adversaire qui n’est pas soumis aux mêmes contraintes.
Ces arguments surévaluent les avantages militaires et sécuritaires procurés par les mines antipersonnel (voir plus haut) et font fi des raisons humanitaires qui sous-tendent la Convention d’Ottawa. Cet instrument se voulait une réponse directe aux souffrances trop longtemps causées par les mines, et documentées dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux partout dans le monde. Dès lors, chaque État partie à la Convention d’Ottawa s’est engagé à ne « jamais, en aucune circonstance » employer (transférer, stocker, etc.) de mines antipersonnel (art. 1 de la Convention d’Ottawa). Comme l’explique un expert juridique, « les circonstances visées par cette expression englobent tant les situations de paix que celles de conflit armé et proscrivent totalement la commission d’actes interdits dans chacune de ces situations [traduit pas nos soins] ». En vertu de la Convention, il est également illicite d’employer des mines antipersonnel à titre de représailles entre belligérants, que l’adversaire ait eu recours ou non à ces engins et quelle que soit la gravité des circonstances, même en cas de légitime défense contre une agression.
La disposition sur le retrait confirme également que les auteurs de la Convention d’Ottawa ont délibérément rejeté l’idée qu’un conflit armé puisse justifier de révoquer l’interdiction vitale posée à l’encontre des mines antipersonnel. Ainsi, il est prévu que le retrait ne devienne effectif que six mois après la réception de la notification par le Secrétaire général de l’ONU – et si l’État qui souhaite se retirer est engagé dans un conflit armé à la fin de cette période, le retrait ne prendra pas effet avant la fin du conflit (art. 20, al. 3, de la Convention d’Ottawa).
Les arguments avancés dernièrement en faveur des mines antipersonnel remettent également en cause certains préceptes fondamentaux du DIH. La thèse selon laquelle un État doit pouvoir se défendre lui-même par « tous les moyens » va à l’encontre d’une règle fondamentale du DIH : le choix des moyens et méthodes de guerre n’est pas illimité (art. 35, al. 1, du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève). La plupart des guerres soulèvent des questions existentielles, en particulier pour les populations directement concernées. Mais ces considérations ne justifient pas le fait que l’on abandonne ou que l’on contourne les protections juridiques conçues pour assurer leur sécurité. Indépendamment des causes d’un conflit – qu’un État mène une guerre d’agression ou qu’il agisse par légitime défense –, le DIH s’applique d’une manière égale à toutes les parties et a pour vocation de protéger toutes les victimes de conflits armés, quel que soit le camp auquel elles appartiennent.
La Convention d’Ottawa, de même que les autres traités imposant des limites aux moyens et méthodes de guerre, a été adoptée pour préserver l’humanité dans les situations de conflit armé. Il est profondément erroné de prétendre que ces instruments obligent à « combattre les mains liées ». Même lorsqu’un adversaire ne tient pas compte de ces règles, il est dans l’intérêt de tout État de respecter les restrictions humanitaires – ne serait-ce que parce qu’elles contribuent à protéger sa propre population civile.
Comme l’a justement déclaré la présidente du CICR, le « droit international humanitaire n’est pas fait pour les temps de paix et les lendemains qui chantent. Il est fait pour les jours les plus sombres de l’humanité, quand les conflits armés font rage et que les populations sont gravement menacées [traduit par nos soins] ».
Si l’on veut préserver l’humanité dans la guerre, il faut renforcer les normes humanitaires et respecter le DIH
Les récentes remises en question de la Convention d’Ottawa soulèvent de profondes préoccupations concernant la sécurité et le bien-être des populations affectées par le fléau des mines. Les retraits et les violations de ce traité affaiblissent à la fois son efficacité et sa crédibilité, rendant une adhésion universelle moins probable et sapant les normes humanitaires qu’il a établies. Cela a pour effet d’accroître le risque d’utilisation et de prolifération des mines antipersonnel, une menace claire et tangible pour les civils. L’histoire nous a montré que les règles du DIH régissant la conduite des hostilités n’ont pas suffi à elles seules pour prévenir ou réduire les immenses souffrances humaines causées par les mines antipersonnel. En 1997, une interdiction juridique générale de ces armes est apparue comme la seule solution efficace, et c’est encore et toujours le cas aujourd’hui.
Les motifs mis en avant pour justifier l’abandon d’instruments humanitaires – et le silence observé face aux violations et aux retraits – génèrent des risques plus larges pour les accords internationaux relatifs au désarmement et au contrôle des armes ainsi que pour la protection des victimes de la guerre. Ces discours sur des régimes d’exception nous placent devant une alternative redoutable : ou bien certains États sont appelés à respecter leurs engagements même si d’autres les ignorent, ou bien tous les États renoncent à leurs obligations, avec pour conséquence une érosion générale de l’état de droit international.
Les normes humanitaires doivent être sans cesse réaffirmées. Il est de la responsabilité des États, des parties aux conflits et, en fin de compte, de nous toutes et tous de rejeter les fausses promesses de sécurité offertes par les régimes d’exception et, à la place, de renforcer la stigmatisation associée aux mines antipersonnel et autres armes qui causent des dommages inacceptables et de promouvoir une application fidèle du DIH. Si l’on en croit les documents finaux issus des réunions des États parties, la majorité de ces derniers veulent un monde libéré de la menace des mines antipersonnel. Aussi imparfaits soient-ils, les instruments humanitaires tels que la Convention d’Ottawa offrent une protection indispensable et des garanties fondamentales pour préserver l’humanité dans la guerre.
Note :
[1] Note de la rédaction : le 12 mars 2025, les Îles Marshall ont ratifié la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Au 13 mars 2025, 165 États sont parties à la Convention d’Ottawa.
Voir aussi :
- Josephine Dresner, From the Middle East to West Africa: responding to the humanitarian impacts of improvised anti-personnel mine, 8 février 2024
- Henrique Garbino and Matthew Bolton, Protecting the innocent, the land, and the body: traditional sources of restraint on landmine use, 23 mars 2023
- Eirini Giorgou, Preventing and eradicating the deadly legacy of explosive remnants of war, February 23, 2023
- Alex Frost, Mitigating the environmental impacts of explosive ordnance and land release, 16 décembre 2021
- Ambassador Hans Brattskar, 50 steps to a mine-free world by 2025,19 décembre 2019