Prévenir le coût humain catastrophique de la guerre est un objectif central du droit international contemporain. Certaines normes, comme celles inscrites dans la Charte des Nations unies, visent à éliminer complètement la guerre, en exigeant la résolution pacifique des différends. D’autres règles, comme celles énoncées dans les Conventions de Genève, s’appliquent pour nous protéger lorsque tout le reste a échoué. Les Conventions, auxquelles tous les pays sont parties, sont au cœur du droit des conflits armés : un ensemble de règles qui limitent le comportement des parties en guerre pendant un conflit, quelle que soit son origine et quels que soient les responsables.
Dans cet article, Cordula Droege, conseillère juridique principale et cheffe de la division juridique du CICR, affirme qu’il est temps de rappeler que l’objectif du droit international humanitaire est de protéger des vies et non de justifier des destructions à grande échelle.
Dans sa définition la plus simple, le droit des conflits armés reconnaît que les deux parties tueront, blesseront et détiendront des personnes et provoquerons inévitablement des destructions, mais il leur interdit de déshumaniser leur adversaire. Transformer cette contradiction apparente en des règles contraignantes est l’objectif des Conventions de Genève et de nombreux autres traités et normes. Ces derniers se heurtent au dilemme de rendre la guerre humaine, non pas en prétendant le résoudre, mais en cherchant à établir un équilibre entre deux impératifs irréconciliables : la nécessité militaire et notre humanité commune.
Ce vaste ensemble de règles est une boussole qui s’applique à la guerre sous toutes ses formes : par exemple, les cibles, le choix des armes, la détention, l’interrogatoire, les poursuites et les sanctions, les soins fournis aux blessés et aux malades, et le traitement des populations placées sous le contrôle d’une partie. Pour chaque facette de la guerre, le droit international humanitaire (DIH) délimite un comportement acceptable – une frontière tracée pour la simple raison que la franchir consumerait notre humanité d’une manière que même la guerre ne peut justifier.
Certaines actions sont toujours interdites : la torture, le viol, la prise d’otages, le fait de prendre pour cible des civils et des blessés. Dans d’autres domaines, les règles sont plus nuancées : les pertes accidentelles en vies humaines doivent être évitées ou, à tout le moins, réduites au minimum ; et lorsqu’elles sont inévitables, elles sont soumises à des restrictions strictes. Dans l’ensemble, le DIH contient des centaines de règles visant à protéger la vie, la santé et la dignité humaine. Elles sont limitées et imparfaites – elles cherchent seulement à garantir un minimum d’humanité dans des situations où celle-ci a déjà été largement compromise.
Cette approche pragmatique constitue la force du droit de la guerre. Le DIH est universellement reconnu en partie parce qu’il reflète une réflexion approfondie sur la conduite des conflits armés et la manière de l’emporter. Il est un filet de sécurité permettant aux forces armées de remplir leur mission tout en atténuant certaines des pires conséquences de la guerre. Cependant, malgré ses nombreux atouts, le droit est mis à rude épreuve. Comment continuer à tenir compte des lois de la guerre alors qu’un si grand nombre de civils périssent dans les conflits, souvent parce qu’ils sont délibérément pris pour cible, mais aussi parce que des opérations militaires faisant fi de la protection de la population civile sont présentées comme licites ? Les règles sont-elles inadéquates ? Ou est-ce leur application qui fait défaut ?
Quelle est précisément la nature du problème ?
Non-respect, impunité et contournement des limites fixées par le droit
Le non-respect et l’impunité sont des problèmes évidents. Le fossé béant entre les règles établies et la réalité sur le terrain a toujours représenté un défi majeur pour le droit des conflits armés. Des violations sont commises à la vue de tous, alimentant un sentiment de désillusion compréhensible, voire un certain cynisme. Les États, les institutions internationales et les groupes armés non étatiques (souvent soutenus par des gouvernements) doivent tous intensifier leurs efforts pour mettre fin à l’impunité.
Néanmoins, le non-respect des règles n’est qu’une partie du problème. Des forces plus subtiles, mais tout aussi pernicieuses, sont également à l’œuvre. Les Conventions de Genève ont été élaborées pour empêcher la répétition des horreurs infligées aux soldats et aux civils durant les deux guerres mondiales. Cependant, dans l’histoire plus récente, le DIH a été instrumentalisé par des parties à des conflits armés pour justifier leurs actions lorsque celles-ci s’écartaient des obligations en principe en vigueur en temps de paix, notamment en matière de droits humains.
En résumé, la guerre, telle qu’elle est régie par le DIH, est dorénavant perçue comme un paysage moral et éthique alternatif — un espace dans lequel les États se considèrent libres d’appliquer un degré inouï de force et de contrôle militaire, à l’intérieur et à l’extérieur de leur propre territoire, tout en conservant la posture d’acteurs respectueux du droit.
En théorie, cette conception n’est pas toujours entièrement fausse, mais elle passe dangereusement à côté de l’enjeu essentiel. Oui, le DIH est réaliste quant au nombre de morts et à l’ampleur des destructions qui se produiront inévitablement en temps de guerre. Cependant, il y a une différence entre le droit qui accepte un certain degré de violence et le droit qui l’encourage. Le DIH fixe des lignes rouges ; il n’établit pas de normes pour un comportement idéal.
Trop souvent, aujourd’hui, le rôle protecteur du DIH est mis de côté et la logique de ses règles est littéralement renversée : au lieu de les interpréter comme ayant pour but de protéger les civils, c’est l’absence de violations claires de ces règles qui est invoquée pour justifier un nombre de morts, de blessés et de destructions que le DIH permettait précisément d’éviter. On entend alors la rengaine « humainement intolérable, mais juridiquement acceptable [« awful but lawful »] », qui pourrait accompagner une vague dramatique de pertes civiles. Dans certains cas, c’est ce qui a pu se produire. Mais depuis quand se contenter de ne pas enfreindre le droit est-il une source de fierté ? Ne devrait-on pas plutôt être consternés d’avoir frôlé de si près la ligne rouge ? Le respect du DIH doit permettre d’accomplir son objectif humanitaire, pas de contourner les limites qui ont été fixées.
Une interprétation déconnectée de l’objectif
Parallèlement, les règles sont interprétées de manière de plus en plus déconnectée de leur objectif. Le DIH, comme les autres branches du droit, comporte sa part d’ambiguïté. Le droit reste imprécis dans certains domaines, parce que les lois doivent parfois éviter d’être trop prescriptives. Ce manque de précision n’est pas un problème en soi, mais il nous oblige à attacher beaucoup d’importance au fait de dûment prendre en compte les fondements sur lesquels repose ces règles dans nos interprétations. Ces principes fondamentaux, en particulier ceux qui s’attachent à la valeur de la vie humaine, sont aujourd’hui menacés.
Voici un exemple. Le droit international n’interdit pas tous les dommages collatéraux en cas de bombardement. Cependant, il exige que les victimes civiles soient évitées autant que possible ; et surtout, il interdit tout dommage civil causé incidemment et qui serait excessif par rapport à l’avantage militaire attendu en éliminant une cible légitime. C’est un critère d’équilibre – une caractéristique commune du droit, tant international que national. Lorsqu’appliquée de bonne foi, cette règle peut sauver nombre de vies (et elle l’a fait). En revanche, elle repose sur l’hypothèse que la vie des civils a une certaine valeur ; et surtout que toutes les vies des civils ont une valeur égale.
Il est facile de comprendre ce qui peut conduire – pour des raisons aussi évidentes que déplorables – les commandants à dénigrer les vies de ceux qu’ils associent à leurs adversaires. Mais il est également facile de comprendre comment le fait de nier la valeur de la vie des civils finira par vider le droit de son sens. Le DIH ne peut avoir un impact sur la vie, la santé et la dignité des victimes des conflits armés que s’il est interprété de manière à les protéger véritablement. Quel rôle le droit humanitaire peut-il véritablement jouer si les personnes qu’il est censé protéger ont déjà été déshumanisées ?
Cette tendance devient d’autant plus pernicieuse lorsque l’on constate que la plupart des États accordent plus d’attention à certaines victimes de certains conflits armés qu’à d’autres. Ceci n’est qu’un exemple de la manière dont le DIH est fragilisé par des interprétations qui sont le fruit de calculs intéressés, destinées à autoriser des opérations militaires permissives à court-terme. Cependant, à long terme, si l’application opportuniste du DIH continue de gagner du terrain, nous assisterons, impuissants, au basculement du fragile équilibre du droit qui, au lieu de sauver des vies, deviendra simplement un autre outil au service de la puissance militaire.
Comment les États peuvent intervenir pour remédier à ces difficultés
Les États doivent agir pour inverser cette tendance. Dans les systèmes nationaux, les tribunaux et les législateurs veillent souvent à ce que les lois ne soient pas détournées de leur objectif. Ces institutions sont rares sur la scène internationale, et il revient aux États de s’assurer que le DIH remplit son objectif initial. Ils peuvent faire beaucoup, en commençant par appliquer le DIH de bonne foi et en gardant à l’esprit les conséquences des interprétations qui sacrifient le but humanitaire du droit au profit de l’opportunisme militaire.
Les États peuvent également montrer l’exemple et appliquer les mêmes normes à tous, sans traitement de faveur. Ils peuvent s’influencer mutuellement en conditionnant l’aide militaire et les transferts d’armements. Ils peuvent réduire l’incertitude juridique en adhérant à des traités qu’ils n’ont pas encore ratifiés. Et ils peuvent tenir les violateurs responsables de leurs actes devant leurs tribunaux nationaux.
Personne ne peut sérieusement prétendre que le droit des conflits armés est inadapté à son but – les États et leurs forces armées l’ont élaboré après deux guerres mondiales précisément dans cet objectif – et aucun État du monde ne nie les obligations qui lui incombent au titre du DIH. Néanmoins, le fait d’instrumentaliser le droit au service d’objectifs politiques peut menacer sa raison d’être, et ainsi sa légitimité. Les États et leurs conseillers juridiques doivent prendre au sérieux leur responsabilité de faire respecter les lois de la guerre– pas seulement les règles, mais aussi l’esprit du droit.
Les Conventions de Genève sont nées des ruines de Varsovie et de Leningrad, pour lutter contre la déshumanisation totale de millions de civils et de prisonniers. Elles ont 75 ans cette année et ont été complétées par les Protocoles additionnels de 1977 et d’autres règles du droit international humanitaire qui renforcent la protection des civils. Beaucoup de progrès ont été accomplis, mais lorsque nous voyons les ruines de Raqqa, d’Alep, de Marioupol et de Gaza, ou lorsque nous constatons les conditions inhumaines de détention dans lesquelles sont maintenues les personnes dans de nombreux conflits actuels, cela n’est pas suffisant. Les victimes des conflits armés n’ont pas besoin de discours creux sur le DIH. Elles n’ont pas besoin d’entendre que les morts dans leur communauté ne peuvent pas être qualifiés de crimes de guerre. Elles ont besoin d’une culture universelle de respect du DIH dans laquelle les États s’abstiennent consciencieusement de commettre des violations et imposent à leurs forces les normes les plus élevées.
Et à ceux qui, par leur argumentation juridique rigoureuse, parviennent à justifier le fait qu’un hôpital sauvant des vies ait été détruit en respectant le droit, ou que la douleur atroce infligée à un détenu ne relevait techniquement pas de la torture : vous aurez gagné la bataille, mais nous perdrons tous la guerre.
Cet article a été initialement publié en anglais, sur Just Security puis sur ce blog le 18 juillet 2024. Il a été traduit par Raphaëlle Duhamel, en Master 1 de Traduction spécialisée multilingue de l’Université de Grenoble Alpes, en France.
Voir aussi :
- Julie Lefolle, Kay von Mérey, Silvia Gelvez, Elizabeth Rushing, La jeunesse d’aujourd’hui, le droit international humanitaire de demain… 27 mai 2024
- Cordula Droege, Défendre le respect du DIH dans les conflits armés contemporains : l’édition 2024 du rapport du CICR sur les défis posés au DIH, 31 octobre 2024




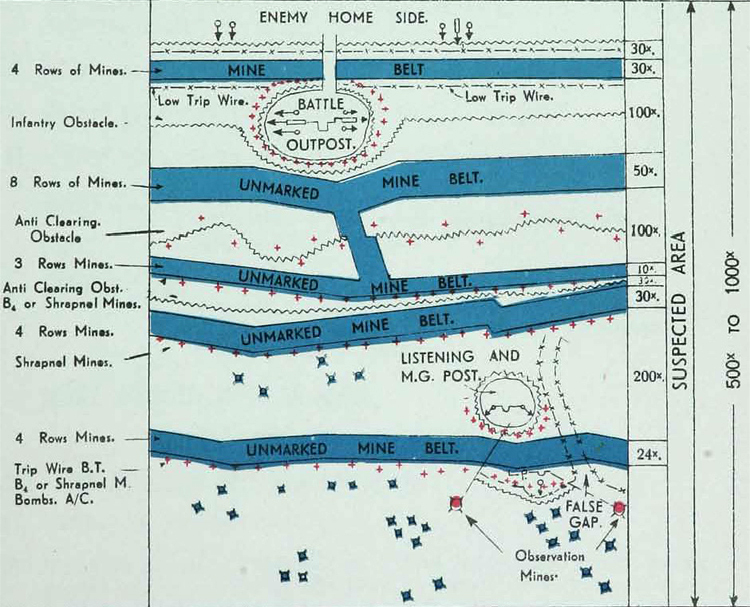

Comments