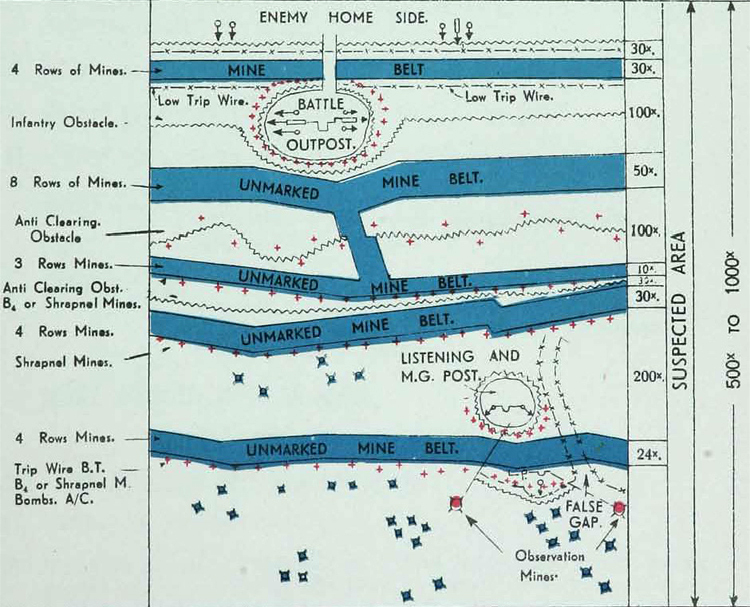Le langage compte et la protection conférée par le droit international est essentielle pour lutter contre le phénomène global de la déshumanisation. Les discours qui déshumanisent privent les personnes de leur dignité et facilitent la justification de traitements inhumains, de la torture, et du refus d’accorder une protection juridique.
Dans cet article, Terry Hackett, chef de la Division des personnes privées de liberté au CICR, souligne l’impérieuse nécessité de s’opposer à la déshumanisation, de garantir que les personnes soient traitées avec humanité et de renforcer le respect du droit international afin de protéger la dignité et les droits des détenus, partout dans le monde.
Imaginez un instant que vous ayez perdu le contrôle de votre vie. Vous êtes traité comme un animal, un chiffre, un parasite ou un objet. Votre famille ne sait pas si vous êtes vivant ou mort. Les autres ne vous perçoivent plus ou ne vous reconnaissent plus comme un de leurs semblables. En conséquence, on vous affirme que vous ne méritez plus la protection juridique à laquelle les autres ont droit. Vous ne faites plus partie de l’humanité.
Cela peut sembler radical et peu probable. Toutefois, c’est la réalité quotidienne de centaines de milliers de personnes détenues en lien avec un conflit armé ou d’autres situations de violence, partout dans le monde.
La déshumanisation comme moyen d’oppression
Des personnes privées de liberté, soumises à un traitement inhumain et à la torture, privées de contact avec leur famille de façon délibérée, utilisées à des fins politiques, confrontées à des conditions de détention catastrophiques et qui se voient refuser l’accès à des services de base. Ces actes sont à la fois un facteur et un symptôme d’un phénomène plus général de déshumanisation, comme l’a analysé Nathalie Deffenbaugh et comme le constate le CICR dans ses opérations humanitaires à travers le monde.
Malheureusement, souvent, ce discours est émaillé de propos justifiant des violations présumées du droit international humanitaire ou fondé sur des interprétations bien trop permissives du droit. Dans certains cas, ces propos sont le précurseur d’arguments non pertinents sur le plan juridique, visant à refuser à des catégories entières de détenus la protection que leur confère le droit international humanitaire.
Le langage déshumanisant précède ou accompagne souvent la violence infligée aux détenus ou le fait d’imposer délibérément des conditions de détention inhumaines. Pour les auteurs de ces violences, il est bien plus facile de soumettre quelqu’un à des mauvais traitements ou à la torture, de lui refuser l’accès à des services de base, de couper le contact avec ses proches et de justifier la suppression de sa protection juridique lorsqu’une ou plusieurs personnes sont considérées comme des animaux, des objets ou une maladie, plutôt que comme d’autres êtres humains.
La déshumanisation est un cercle vicieux. Une fois qu’elle commence, les traitements inhumains qui s’en suivent rendent d’autant plus difficile de lutter contre le langage, la perception et la haine induits par la déshumanisation. Il faut condamner les discours et les actes qui déshumanisent et y mettre un terme immédiatement, car ils ne se contentent pas d’infliger des souffrances à des personnes privées de leur liberté et de leur famille. Ils portent également atteinte à notre humanité commune, en contrevenant aux règles que nous avons établies ensemble, en tant que communauté internationale, à travers la ratification universelle des Conventions de Genève.
Donc, concrètement, que peut-on faire ?
Condamner la déshumanisation : un impératif juridique et humanitaire
Premièrement, toutes les personnes privées de liberté, quelle que soit leur appartenance ou le motif de leur accusation ou de leur condamnation, doivent être reconnue dans le langage et dans l’action simplement comme ce qu’elles sont : des personnes.
Les personnes sont protégées par le droit, elles ont des noms, des familles et des identités et elles ont le droit d’être traitées avec dignité et d’être prises en considération.
Cela commence par reconnaitre que nul n’échappe à la loi.
Le droit international humanitaire est une branche du droit inclusive, conçue pour protéger notre humanité individuelle et collective dans le chaos de la haine lors d’un conflit armé.
L’obligation absolue de traiter avec humanité les personnes privées de liberté ainsi que d’autres dispositions sont un fil conducteur entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, qui offrent des protections solides à plusieurs niveaux et qui se recoupent souvent. Refuser à une personne un traitement humain n’est jamais justifiable, ni excusable.
Deuxièmement, l’obligation de traitement humain doit être mise en œuvre en toutes circonstances et sans exception. Cela comprend bien entendu des aspects fondamentaux, tels que la garantie de fournir de la nourriture, de l’eau en quantité adéquate et des conditions d’hygiène et des soins médicaux essentiels, ainsi qu’un réel contact humain.
L’humanité en détention : le rôle de la technologie et des interactions humaines
Le développement de technologies fondées sur l’intelligence artificielle en milieu carcéral, à moins que celles-ci s’appuient sur les règles du droit international, peut réduire l’humanité des personnes privées de liberté à une série de 1 et de 0. La technologie doit être élaborée et appliquée de façon à faciliter de véritables interactions humaines bénéfiques, sans être un obstacle qui sépare davantage les autorités détentrices des détenus.
Par « véritables interactions humaines », on entend les interactions avec la famille et le monde extérieur. Ces interactions impliquent en premier lieu que les autorités remplissent leurs obligations de s’assurer que les familles connaissent le sort de leurs proches et le lieu de leur détention. En dehors de ces informations, un contact régulier entre les détenus et leurs familles doit également être facilité et organisé de façon effective. Bien que la technologie puisse permettre aux détenus d’interagir virtuellement avec leurs familles, celle-ci ne peut pas remplacer le contact direct.
Si le langage compte, les actes comptent d’autant plus. Nous devons tirer les innombrables leçons de l’histoire qui montrent comment la déshumanisation par le langage et les mauvais traitements des détenus mènent à des souffrances innommables et portent atteinte à notre humanité commune.
Renforcer la détermination à respecter le droit international humanitaire
Le 12 août 2024, nous avons fêté le 75ème anniversaire des Conventions de Genève, qui nous rappelle que le monde s’est mis d’accord pour mettre des limites à la guerre, au bénéfice de la protection de notre humanité partagée. Aujourd’hui, alors que nous constatons que le droit international humanitaire est interprété avec une élasticité toujours plus importante, il en va de la responsabilité de tous les États de renforcer leur détermination à respecter le droit et ses principes inscrits pour protéger les civils et les personnes privées de liberté.
La détention dans les conflits armés et la façon dont les personnes sont traitées dans les lieux de détention doivent être fondées sur le droit international, non sur une rhétorique.
Note de la rédaction : Cet article a été initialement publié en anglais dans The Interpreter et est disponible ici. Il a été publié sur le blog en anglais le 7 novembre 2024.
Voir aussi :
- Ellen Policinski, Héritées de la guerre : 75 ans après, les Conventions de Genève gardent toute leur importance, 12 août 2024
- Yvette Issar, Un filet de protection pour les prisonniers de guerre : cinq principes fondamentaux de la Troisième Convention de Genève, 25 juillet 2023